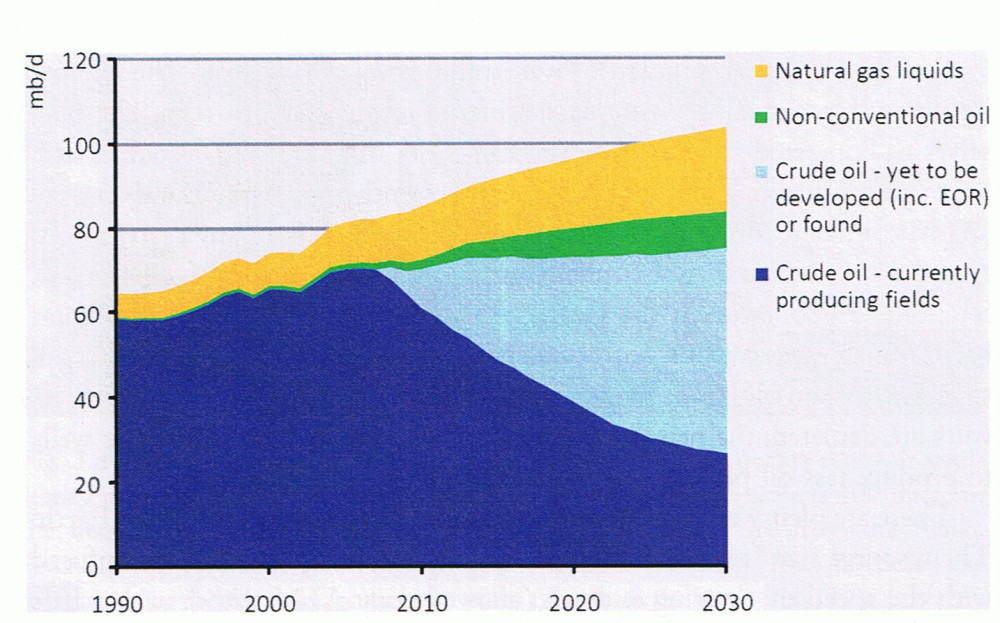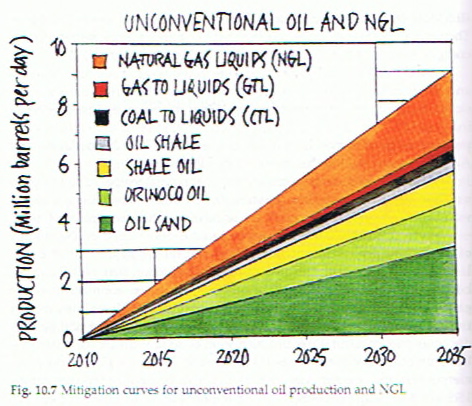Publié par Harvey Mead le 27 Mai 2015 dans Blogue | Aucun commentaire
Dans une note envoyée juste avant mon départ pour la Chine, Jocelyne Néron demande ce que je pense des travaux de Dialogues pour un Canada vert (SCD), dont la publication date de mars 2015 et que je ne connaissais pas. Voilà que je suis de retour, et je viens de consulter les documents produits par ce regroupement impressionnant de chercheurs universitaires canadiens de toutes les provinces et qui s’attaque au défi des changements climatiques. Précédent les travaux de SCD, le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIÉC) avait déjà publié son cinquième rapport, la première partie en septembre 2013, les deux autres en mars et avril 2014. Il s’agit du point de départ pour toute intervention dans le domaine, mais dans la foulée du rapport du GIÉC, je ne comprends pas ce que les chercheurs du SCD pensent être en train de faire.
Un contexte incontournable: le budget carbone
Le rapport du GIÉC de septembre 2013 établit la quantité totale de carbone que l’humanité peut se permettre d’émettre tout en se donnant une chance raisonnable de maintenir la hausse de température en dessous de 2 degrés. Peu après, en novembre 2013, Renaud Gignac a produit pour l’IRIS une note d’information portant sur ce budget carbon. L’étude part des travaux du GIÉC et introduit dans la réflexion, et dans les calculs, une orientation de contraction/convergence qui propose que toute intervention sérieuse en matière de changements climatiques doit tenir compte des énormes déséquilibres actuels entre les différents pays en matière d’émissions (et d’usage d’énergie, et de niveau de vie, et …). Cela en sus d’une prise en compte du budget carbone lui-même.
À l’échelle internationale, les travaux du Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP) menés par Jeffrey Sachs et lancés pendant l’été 2014 partaient aussi avec l’engagement de respecter ce budget carbone calculé par le GIÉC. Dans la première version globale de la publication qui présente ses résultats, le DDPP en septembre 2014 n’était pas capable d’imaginer des propositions susceptibles de respecter le budget carbone pour l’ensemble de l’humanité. Le DDPP promet sur son site une mise à jour globale d’ici la fin de juin, mais rien sur le site ne suggère que les résultats ont changé. Le DDPP semble beaucoup plus sérieux que d’autres récentes interventions, comme celle de Risky Business menée par des milliardaires américains ainsi que l’initiative de la commission de Nicholas Stern et Felipe Calderon, New Climate Economy, que j’ai déjà commentés.
Le DDPP inclut une équipe qui travaille sur les possibilités pour le Canada de participer à cet effort international qui inclurait le respect du budget carbone dans les négociations pour la COP21 qui auront lieu d’ici décembre 2015. La première étape du travail était d’identifier le potentiel technologique pour respecter le budget carbone; une deuxième étape promise portera sur les coûts/bénéfices de telles interventions. Le groupe ne semble pas promouvoir une approche contraction/convergence, mais son effort d’intervenir au niveau mondial (il y a 15 pays ayant 70% des émissions globales qui sont couverts par le travail fait à date) semble fournir une approche complémentaire. Le défi: réduire les émissions per capita de 20,61 tCO2e/cap à moins de 2 d’ici 2050. Les réductions viendraient de deux sources principales: une réduction dans l’intensité de carbone dans l’utilisation d’énergie et une réduction dans l’intensité énergétique de l’économie elle-même (6-7).
L’équipe pour le Canada (qui n’inclut pas les chercheurs impliqués dans le SCD) confronte directement le dossier des sables bitumineux. Elle souligne la nécessité incontournable de la mise en oeuvre d’un ensemble de technologies (surtout celle de la capture et séquestration des émissions) à toutes les étapes du processus de développement des ressources qui sont responsable d’environ 35% des émissions canadiennes (30). Elle souligne aussi que les coûts de ceci risquent d’être très élevés et suggère – sans l’inclure dans le travail, fidèle à la méthodologie du DDPP – qu’une approche qui comporterait des échanges de crédits de carbone entre différents pays (comme le mécanisme de développement propre de Kyoto) sera plus efficiente.
Un article de novembre dernier de David Roberts dans Grist souligne comme moi que le travail du DDPP est parmi les plus importants en cours actuellement, précisément parce qu’il reconnaît le budget carbone comme balise fondamentale. Roberts poursuit ses réflexions dans d’autres articles, dont
un de janvier 2015 qui insiste sur la nécessité d’une quantification des composantes des travaux sur la décarbonisation. Il s’agit d’un effort de bien cerner les défis en cause.
Où se positionne le SCD?
Dans un tel contexte, le SCD est désappointant à plusieurs égards:
(i) SCD ne fait que mentionner le budget carbone et ne présente aucune cible quantitative tenant compte des travaux du GIÉC. Il n’est tout simplement pas possible de voir le lien entre leurs objectifs quantitatifs et ceux du GIÉC. Ils proposent qu’il est possible d’imaginer pour 2035 que la production canadienne d’électricité soit 100% fondée sur les énergies renouvelables (actuallement, les sources non fossiles représentent seulement 23% de l’ensemble), et qu’une réduction des émissions globales d’au moins 80% pour 2050 semble possible. Les références fournissent probablement les détails pour ces projections, mais nulle part n’est-il question du respect ou non du budget carbone comme guide pour leurs propositions.
(ii) SCD ne touche presque pas au défi de l’exploitation des sables bitumineux, proposant tout simplement que toute aide gouvernementale en soit retirée et qu’un prix sur le carbone soit établi. Comme tout le monde, SCD souligne qu’il serait plus qu’intéressant si des technologies de capture et séquestration des émissions s’améliorent et deviennent disponibles.
(iii) L’exploitation des sables bitumineux est presque exclusivement pour exportation, et leur consommation ailleurs n’affecte donc pas, directement, les émissions canadiennes. SCD ne semble d’aucune façon aborder la question de l’équité internationale soulignée par les travaux de l’IRIS sur le budget carbone, et faisant partie de la méthodologie du DDPP. Seule les émissions résultant de l’extraction et du raffinage rentrent dans leurs perspectives, d’après la meilleure lecture que je puis faire de leur publication.
Le document est guidé partout par la pensée de l’économie verte et, comme d’habitude pour cette pensée, n’aborde pas l’analyse des changements qu’il semble présumer en ce qui a trait aux contraintes sociales, politiques et économiques liées à la transition, qui se présente pour le SCD tout simplement comme faisable. Les politiques climatiques proposées sont censées avoir plusieurs caractéristiques : elles doivent être efficaces sur le plan environnemental, comporter un bénéfice net en matière de coût, être faisable sur le plan administratif, être équitable et être faisable sur le plan politique. Le document souligne que l’ensemble des propositions ne peut répondre aux 5 critères en même temps.
Pour situer ces critères, la note 46 réfère au texte de Jaccard et Rivers «Canadian Policies for Deep Greenhouse Gas Reductions», écrit pour l’IRPP en 2007, au moment de la publication du rapport précédent du GIÉC, et qui cible des réductions d’émissions d’environ 60% d’ici 2050. La référence confirme ma lecture des documents de SCD à l’effet qu’il s’agit d’une sorte de synthèse de propositions qui circulent depuis des années, tout à fait intéressantes, voir stimulantes, mais qui manquent une méthodologie partant des contraintes établies par le GIEC dans son cinquième rapport de 2013-2014, même si le document du SCD cible des réductions des émissions de 80% pour 2050 (27-28).
Quelques détails
SCD semble proposer de maintenir une grande consommation d’énergie, «simplement» convertissant l’économie et la société dans la transition et ayant comme objectif un recours aux énergies renouvelables pour décarboniser l’électricité; je ne trouve aucune indication d’un calcul quant aux émissions associées anx importants projets d’infrastructures ainsi inclus dans les orientations (mais voir la référence de la note 64 qui date de 2011 et dont un résumé est en ligne) ni d’une reconnaissance que nous consommons une énorme quantité d’énergie qu’il est difficile d’imaginer possible pour l’ensemble de l’humanité.
Tout le secteur du pétrole et du gaz se trouve encadré par SCD avec la proposition «d’intégrer le secteur de la production dans les politiques climatiques» qui comporte «une réglementation claire et cohérente avec la transition» (33), sans aucun détail que je puisse trouver. SCD s’attaque aux transports en ciblant de meilleures normes d’émissions, une électrification du transport routier, une diminution de la dépendance à l’auto privée et une amélioration des transports inter-cité et inter-modaux (34-35). Et elle met comme élément critique une amélioration importante de l’efficacité énergétique.
À titre d’exemple du défi qui ne semble pas pris en compte explicitement : le Québec propose de réduire ses émissions de 20% d’ici 2020 (c’était 25%, pour le gouvernement péquiste). Non seulement la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec a-t-elle conclu qu’une réduction de 15% pour 2025 semble être le maximum atteignable, mais les calculs de Gignac pour l’IRIS concluent qu’il faudrait une réduction de 40% d’ici 2020 pour arrêter de cumuler les déficits face au budget carbone. SCD ne semble pas regarder de tels détails.
Il y a une série d’orientations dans le chapitre 3 qui ciblent une amélioration de la biodiversité et de la qualité de l’eau et une transition vers des approches soutenables à l’agriculture, à la foresterie et aux pêches tout à fait dans la lignée de l’économie verte, qui ne fournissent aucune indication quant à ce qui pourrait changer les orientations actuelles. La section 3.4 souligne ce que nous savons depuis les premières pages, que SCD représente une intervention de scientifiques canadiens experts dans les domaines en question. La proposition dans 3.4 est de construire une gouvernance qui permetta la soutenabilité, et suivent des pages qui soulignent l’importance de la science dans la prise de décision et qui vont à l’encontre de près de 10 ans de gestion par le gouvernement conservateur.
Finalement, une autre intervention pour une économie verte
Il est intéressant de voir cette intervention d’universitaires canadiens qui ne sont pas bâillonnés par ce gouvernement, mais il y a du travail important qui reste à faire pour qu’elle soit une véritable contribution. Le document contient un ensemble de propositions tout à fait intéressantes mais ayant été le sujet de débats et d’analyses depuis des années, voire des décennies. L’absence de tout effort de quantifier sérieusement les implications de ces propositions, et surtout l’absence de tout effort d’intégrer les énormes contraintes imposées par le budget carbone et la nécessité de mettre en place un processus de contraction/convergence enlève presque tout l’intérêt du travail. N’importe qui qui a suivi le secteur connaît ces orientations (nous y travaillions à la Table ronde nationale en 2002-2005), mais le GIÉC nous met devant un défi qui n’a pas été inclus dans les débats antérieurs.
Acting on Climate Change: Solutions from Canadian Scholars reflète l’ensemble des documents qui soutiennent la volonté de voir arriver une économie verte. Le thème est explicite dans la Conclusion (53), tout comme dans la traduction française de SCD fournie par Catherine Potvin, une des auteurs du document, dans son chapitre pour le tout récent livre Sortir le Québec du pétrole[1] que je commenterai dans un prochain article. Elle y résume les travaux du SCD où il n’y a aucune analyse fournie pour suggérer ce qui pourrait bien changer les orientations des dernières années, des dernières décennies, qui ont rendu le développement durable un rêve du passé plutôt qu’une orientation d’avenir. Pour Potvin, ce vocable, transformé en «viabilité», serait pourtant censé comprendre l’idée «d’augmenter le mieux-être des personnes dans le respect de l’environnement» (p.64, mes italiques).
La Conclusion réfère également aux travaux de la commission de Nicholas Stern et Felipe Calderon et l’initiative du New Climate Economy, que j’ai déjà commentés. Encore une fois, l’ensemble représente des efforts fondés dans la science et dans l’analyse pour essayer de répondre aux énormes défis actuels. Comme SCD note à la toute fin, «plusieurs des orientations et actions proposées pourraient être mises en œuvre complètement dans les 15 prochaines années, s’il y a une volonté politique et des efforts d’engager des acteurs à travers tous les secteurs de la société» (mes italiques). La couleur rose de l’économie verte ne peut être plus clairement exprimée.
Ici au Québec, nous n’avons pas à regarder loin pour comprendre que de telles conditions n’existent toujours pas, pas plus qu’elles n’existent à l’échelle canadienne ou mondiale. L’ensemble des décideurs cherchent toujours la croissance comme objectif premier de toute intervention et les promoteurs de la croissance verte manquent toujours à l’appel quand il est question de montrer les changements dans les processus décisionnels qui permettent de croire à leur option.
[1] Sortir le Québec du pétrole, sous la direction de Ianik Marcil, Éditions Somme toute 2015


 by
by  Lire la suite
Lire la suite