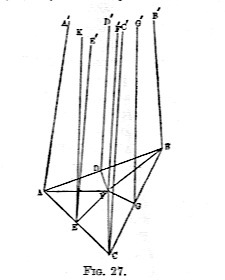Publié par Harvey Mead le 15 Fév 2014 dans Blogue | Aucun commentaire
Dans mon texte sur l’échec du mouvement social, je mets un accent sur l’adhésion des leaders de ce mouvement au discours sur l’économie verte. Suivant les économistes hétérodoxes, dont les orientations rejoignent les leurs, ces leaders cherchent aujourd’hui à intégrer dans leurs interventions une prise en compte des défis écologiques. Arrivant à ceci plutôt récemment, ils semblent voir dans le discours sur le développement durable, transformé après un quart de siècle dans un discours sur l’économie verte, la bonne voie. Ils reprennent ainsi les objectifs du mouvement environnemental sans réaliser que celui-ci les proposent depuis des décennies.
Bruno Massé a fait un article sur cette problématique dans le Huffington Post en décembre, citant mon entrevue avec Éric Desrosiers dans Le Devoir, et des interventions de David Suzuki que j’ai déjà citées dans le texte sur l’échec du mouvement social, comme point de départ. Il poursuit en insistant sur la dérive que constitue le développement durable – et maintenant l’économie verte. Selon son analyse, c’était un contrat faustien où le mouvement environnemental a vu la chance d’influer plus directement sur les causes des crises, les intervenants des milieux économiques, mais en cédant leurs principes. Massé trouve que c’est ce contrat qui est à l’origine de l’échec aujourd’hui constaté par plusieurs et il a probablement raison que c’était, finalement, une mauvaise piste. Aujourd’hui, «la dissonance cognitive a atteint son paroxysme et le mouvement n’a plus le choix, il doit s’éteindre ou devenir autre chose», conclut-il. Et il promettait de revenir avec ses propres pistes.
Il tient sa promesse dans un deuxième article paru le 2 février dans le même Huffington Post. Il y propose «quatre pistes de réflexion pour un mouvement environnemental efficace, solidaire et mobilisant». Le première est l’adoption d’une «realpolitik écologiste», qu’il associe à une «stratégie qui s’appuie sur le possible, négligeant les programmes abstraits et les jugements de valeur, et dont le seul objectif est l’efficacité». C’est étonnant de voir cette première proposition, qui suggère que les décennies d’action du mouvement environnemental marquaient des efforts dans l’abstrait, et non dans la recherche du possible. Pourtant, cela est précisément son analyse du contrat faustien où le mouvement environnemental a cherché à paraître «réaliste» dans l’espoir de pouvoir négocier avec les milieux économiques et politiques. Il distingue son realpolitik d’une «conception de ce qui est viable politiquement et intéressant pour les médias de masse, plutôt que ce qui est nécessaire au sens réel»; il attribue cette conception au mouvement environnemental et l’appelle une approche abstraite. À la place, il faut des propositions qui sont «proportionnelles aux problèmes». Il m’est impossible de voir comment il pense que cela représente le «possible».
Sa deuxième piste est la création d’une alliance avec les luttes sociales. Ici je le rejoins, au point où j’y vois quelques chances pour s’adapter aux effondrements qui viennent (mais à noter les commentaires sur mon blogue qui soulignent l’énorme défi que cela représente). «Une fois les causes environnementales et sociales unies, il devient possible de passer d’une position défensive (la résistance) à une position offensive (la transgression)», dit-il. Il est probablement vrai que le mouvement environnemental a trop mis un accent sur les enjeux écologiques en laissant à d’autres les causes sociales, mais de la même façon, le mouvement social a laissé aux environnementalistes le soin de mener les batailles pour la sauvegarde des écosystèmes. Ce dernier mouvement montre une naïveté face aux défis en cause, maintenant qu’il en est beaucoup plus conscient, beaucoup trop tard. Massé semble rejoindre cette naïveté en suggérant que la combinaison d’offensives sociales et écologiques – ni l’un ni l’autre des mouvements n’a été restreint à des approches défensives, comme Massé suggère – est dans le domaine du realpolitik.
La troisième piste de Massé est la construction d’un contre-pouvoir effectif, c’est-à-dire «tangible, matériel, immédiat dans le temps et l’espace». La faiblesse de cette piste se manifeste dès l’énoncé, alors que Massé suggère que des décennies de sensibilisation ont réussi et qu’il ne reste que des «résistances au changement» à combattre, dont le déni et la récupération du message. Encore une fois, Massé quitte son analyse du premier article et rentre dans un discours d’une extrême simplification. Il a probablement raison que les personnes au sommet de la hiérarchie ne peuvent pas être rejointes – je le constate depuis trop longtemps déjà – , mais il ne semble pas voir que le public est justement à des décennies de comprendre les efforts de sensibilisation du mouvement environnemental – et les décideurs le savent. Il reste lui-même dans l’abstrait en insistant que «le pouvoir effectif est incontournable» et en suggérant qu’un réseau de «solidarité démocratique, tangible, réelle, qui peut se manifester physiquement dans l’espace» est un moyen de mieux poursuivre le changement de paradigme nécessaire. Reste que le Jour de la Terre 2012 semblait offrir un potentiel en ce sens que tout le monde a manqué. J’ai commenté le manque de leadership qui était en cause.
Finalement, la quatrième piste de Massé représente sa reconnaissance de «la lutte pérenne contre le désespoir» ressenti par nous qui constatons les échecs. «Être écologiste, c’est prendre conscience de l’aliénation de l’espèce humaine avec son habitat». Pour éviter les pièges d’un tel positionnement, Massé souligne la nécessité de créer des «milieux sains, démocratiques et non discriminatoires». Il faut que les militant-e-s se permettent une vie humaine à travers leurs engagements, décourageants dans leur manque de succès. Comme il dit, «il tient de fixer des buts signifiants qui peuvent être remplis de façon satisfaisante». Encore une fois, je rejoins Massé dans cette façon de voir, ayant fait trois biographies différentes pour mon blogue, dont une qui représente mon insistance de rester en contact avec cette nature merveilleuse qui motive mes engagements.
Le problème, et Massé vient proche de le dire, est que voilà, cela représente non pas une piste pour passer outre les échecs, mais bien plutôt le constat des échecs dans un certain calme, en recherchant même un certain plaisir. J’ai essayé de me situer plus profondément dans ce désir humaniste de rester avec un certain contrôle, tout en reconnaissant le déclin en cours, avec mon petit texte «Mouches», écrit au moment où je quittais mon bureau de Commissaire au développement durable. Plus je pense à ce que je constate au fil des écrits dans ce blogue, plus je reviens à mon constat de base, que c’est Socrate qui est mon mentor, celui qui s’est décrit dans sa «profession» comme une mouche à cheval. Le cheval a finalement eu raison de lui, mais seulement après une longue vie pleine de l’expérience humaine. Je m’espère la même chose, même si, seulement dans les dernières semaines, au moins trois ou quatre de mes efforts de piquer le cheval sont restés confrontés à un silence assourdissant.
On sens que Massé est lui-même inconfortable avec le constat d’échec, mais son effort de maintenir un «optimisme opérationnel» comporte autant de dérapages que le mien dans la préparation d’un livre où chaque chapitre présentera un monde possible, mais incohérent avec les possibilités du realpolitik – en dehors de crises.


 by
by  Lire la suite
Lire la suite